Forum
Catégories
- Toutes les catégories 17K
- Motos (Général) 924
- Forum libre (La moto en général) 400
- SAAQ 24
- Trucs, astuces et conseils 80
- Cours de conduite et obtention des permis de moto 5
- Accompagnateur/apprenti 186
- Motos Custom 19
- Motos Sport 2
- Maxi Scooters 3
- Supermotard 2
- Double-usage 8
- Sport-Touring 6
- Pièces, vêtements ou accessoires 18
- Vos essais 2
- Nouveaux membres 36
- SPM (Seulement Pour Motarde) 3
- Personnalisation de moto 3
- Randonnées & café-rencontres 115
- Événements et Randonnées ( Général ) 17
- Planification de randonnées et voyage 57
- Montréal Rive-nord 11
- Montréal Rive-sud 4
- Québec 9
- Beauce/Chaudières Appalaches 1
- Centre du Québec 1
- Estrie 4
- Mauricie 3
- Outaouais 0
- Saguenay - Lac Saint-Jean 0
- Bas-Saint-Laurent 0
- Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 0
- Vos plus belles randonnées 1
- Sécurité et politique 7
- C.S.R 0
- CAPM 6
- Opération Escargot 0
- Tables de discussions 27
- Blagues 5
- Café du coin 21
- Électronique 7
- Systèmes de communication 5
- GPS 1
- Multimédia 25
- Photos des membres 3
- Photos de randonnées et événements 10
- Photos de motos 4
- Vidéos 7
- Vos expériences avec les marchands 6
- Exprimez-vous 4
- Motodirect 31
- Aide 8
- Nouvelles et promotions 3
- Commentaires, suggestions 3
- Modérateurs 3
- Modérateurs-Admins 4
- Équipe de promotion 6
- Archives 15.9K
- Trucs, astuces et conseils (Archives) 815
- Archives (Randonnées) 600
- Archives (Général) 14.4K
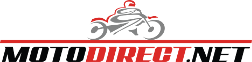

Réponses
Les principaux résultats de
cette étude sont les suivants :
- Dans 37 % des cas, la première
cause de l’accident était
une erreur humaine de la part
du conducteur du deux-roues
à moteur. Dans certaines situations,
les erreurs humaines qui
se sont produites étaient causées
par une certaine inaptitude du
conducteur. Cela est souvent dû
aux circonstances extrêmes dans
lesquelles se déroulent les accidents,
et au manque de temps
dont dispose le conducteur pour
éviter la collision. Dans 13 % des
cas, le conducteur du deux-roues
a pris une décision inappropriée.
- Parmi les facteurs de risque
secondaires, les conducteurs de
deux-roues à moteur n’ont pas
détecté la présence de l’autre
véhicule, et ont commis un grand
nombre d’erreurs dans leurs décisions.
Par exemple, ils ont opté
pour une mauvaise stratégie en
tentant d’éviter la collision.
- Le pourcentage d’accidentés
ayant consommé de l’alcool est
inférieur à 5 %, un taux relativement
bas par rapport à celui
d’autres études. Cependant, ces
conducteurs ont plus de risques
d’être impliqués dans un accident- La comparaison avec les cas-témoins
révèle que la conduite d’un
deux-roues à moteur sans permis
accroît sensiblement le risque
d’être impliqué dans un accident.
- Les conducteurs de deux-roues
à moteur âgés de 41 à 55 ans sont
sous-représentés, ce qui suggère
qu’ils ont moins de risques d’être
impliqués dans un accident que
les autres tranches d’âge.
- La comparaison avec les cas-témoins
révèle que les conducteurs
âgés de 18 à 25 ans sont surreprésentés.
- Dans 50 % des cas, la première
cause de l’accident était une erreur
humaine du conducteur de
l’autre véhicule.
- Les conducteurs d’autres véhicules
possédant un permis
deux-roues ont moins de risques
de commettre une erreur de
perception (par exemple, ne pas
détecter la présence du deuxroues
ou de son conducteur) que
les non détenteurs d’un permis
deux-roues.
- Dans environ 1/3 des accidents,
les conducteurs de deux-roues
à moteur et d’autres véhicules
n’ont pas pris en compte l’obstruction
de leur champ de vision
et ont adopté des stratégies de
conduite inappropriées.
- On constate de fréquentes infractions
au code de la route, dans
8 % des cas pour les conducteurs
de deux-roues à moteur et 18
% des cas pour les conducteurs
d’autres véhicules.
- Parmi la grande diversité des
confi gurations d’accidents et de
collisions observées dans cette
étude, pas une seule ne s’est
avérée plus prévalente que les
autres.
- 90 % des obstacles, qu’il s’agisse
d’un véhicule ou d’un élément
environnemental, se trouvaient
devant le conducteur du deuxroues
à moteur avant l’accident.
- Parmi les principales causes
d’accident, plus de 70 % des conducteurs
d’autres véhicules ayant
commis une erreur humaine
n’ont pas détecté la présence du
deux-roues à moteur.
- La route et les autres véhicules
sont les partenaires de collision
les plus communs. Dans 60 % des
accidents, le deux-roues à moteur
est entré en collision avec
une voiture particulière.
- Les inspections visuelles révèlent
que 17,8 % des cyclomoteurs accidentées
avaient été modifi ées
dans le but d’améliorer leurs performances.
Ce taux est inférieur à
celui obtenu dans les autres études.
Parmi les cas-témoins, on ne note
que 12,3 % de véhicules modifiés.
- Moins de 1 % des accidents
étaient dus à une défaillance technique
du deux-roues à moteur.
Dans la plupart des cas, le problème
concernait les pneus, une
nouvelle preuve de la nécessité
d’un examen régulier du véhicule
par son propriétaire. Aucun
des cas étudiés par nos équipes
ne révèle la présence d’un défaut
de fabrication sur le deux-roues
à moteur.
- Dans plus de 70 % des cas, la
vitesse du deux-roues à moteur
au moment de l’impact était inférieure
à 50 km/h.
- Dans 18 % des cas, la vitesse
du deux-roues à moteur était
supérieure ou inférieure à celle
des autres véhicules l’entourant.
Cette différence de vitesse est
considérée comme un facteur de
risque.
- 73,1 % des conducteurs de
deux-roues à moteur ont tenté
d’éviter la collision immédiatement
avant l’impact. Parmi eux,
32 % ont perdu le contrôle de
leur véhicule en tentant cette
manoeuvre.
- 90,4 % des conducteurs de
deux-roues à moteur portaient
un casque. Cependant, 9,1 % de
ces casques se sont détachés de
la tête de leur propriétaire au
moment de l’accident en raison
d’une mauvaise fi xation ou d’une
détérioration subie par le casque
pendant l’accident. L’étude indique
que dans la plupart des cas, le
casque a contribué effi cacement
à la réduction de la gravité des
lésions crâniennes.
- 55,7 % des conducteurs et des
passagers ont été blessés aux
membres supérieurs et inférieurs.
La majorité de ces blessures
étaient de gravité mineure (abrasions,
lacérations ou contusions).
L’étude révèle que certains types
de vêtements réduisent la gravité
d’un grand nombre de ces blessures
mineures, mais ne les éliminent
pas totalement.
- Les barrières placées en bord de
route constituent un danger peu
commun mais substantiel pour
les conducteurs de deux-roues
à moteur. Elles sont la cause de
graves blessures aux membres inférieurs,
ainsi que de lésions vertébrales
et crâniennes.
- Dans 3,6 % des cas, le mauvais
entretien de la route était la cause
principale ou l’un des facteurs
de l’accident.
- Dans 3,8 % des cas, un obstacle
présent sur la route était la cause
principale ou l’un des facteurs de
l’accident.
- Les conditions météorologiques
étaient la cause directe ou indirecte
de l’accident dans 7,4 % des
accidents de deux-roues à moteur
analysés dans cette étude.
Ce contexte est très différent du nôtre actuel: la 125cc omniprésente dans l'étude est pratiquement inexistante par ici, la majorité de nos motos circulent en dehors des circuits quotidiens (boulot) et depuis cette époque, le nombre des 40 à 70 ans a beaucoup, beaucoup augmenté en nos contrées.
Malgré cela, après lecture approfondie du rapport, je reste convaincu de la pertinence actuelle de la plupart des constats, malgré le fait que plusieurs de ces constats ont besoin d'être adaptés à notre situation actuelle pour être recevables.
Il serait intéressant qu'un exercice semblable soit fait en nos contrées. À l'UQAM, l'hiver dernier, on m'avait informé que ce genre d'études relève des sciences sociales et qu'un tel projet doit donc être celui d'un étudiant dans une telle faculté.
Si l'un des nôtres est en études sociales à l'université, il y aurait possibilité pour faire une telle étude en nos contrées.
8)
On repeuple un pays exactement comme on reboise une forêt. Ça prend 20 ans. Après, le premier imbécile venu y met le feu, on ramène le compteur à zéro et les affaires reprennent.(Greg)
Mais une 2 roues reste une 2 roues... et je crois que ces conclusions s'appliquent ici aussi...
L'europe c'est pas si différent d'ici ...
Le rapport fait d'ailleurs la différence entre les moins de 125cc et les plus de 125cc, car les usages sont différents.
Malgré cela, je suis de ceux qui sont convaincus que les constats de cette étude s'appliquent aussi en notre contexte actuel.
On repeuple un pays exactement comme on reboise une forêt. Ça prend 20 ans. Après, le premier imbécile venu y met le feu, on ramène le compteur à zéro et les affaires reprennent.(Greg)
http://www.moto-station.com/article2290-marche-moto-francais-2006-un-record-historique-.html
on y remarque 50% sont des 125 et moins et 50% sont des 125 et plus ...
Albert Einstein, "Comment je vois le monde", 1934
Design courtoisie de VarloDesign
Ces voies en pavé, généralement en milieu urbain, sont très glissante en cas de freinage subit. Les dommages sont souvent aggravés par ces freinages subits sur pavé.
Personnellement, dans le cas spécifique du Québec, je ferais plutôt un parallèle entre ces conditions de pavé et nos propres conditions, déplorables, en milieu urbain.
8)
Et si je peux me permettre... Ça fait grand bien de te voir revenir dans la discussion, Benoîtbis!
:)
On repeuple un pays exactement comme on reboise une forêt. Ça prend 20 ans. Après, le premier imbécile venu y met le feu, on ramène le compteur à zéro et les affaires reprennent.(Greg)